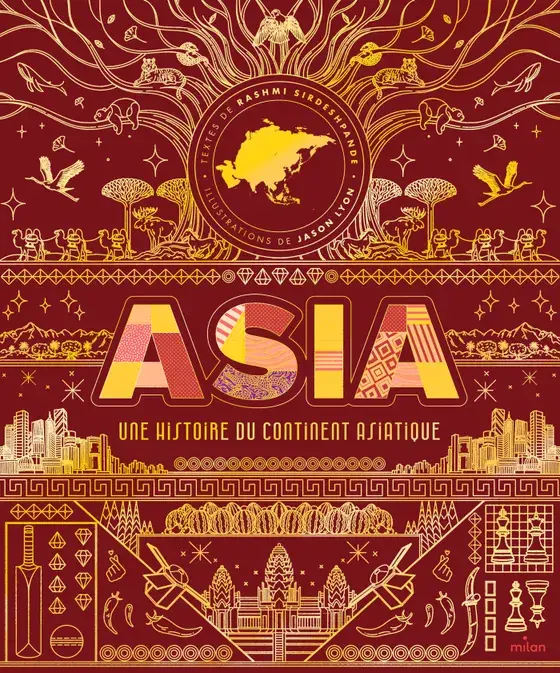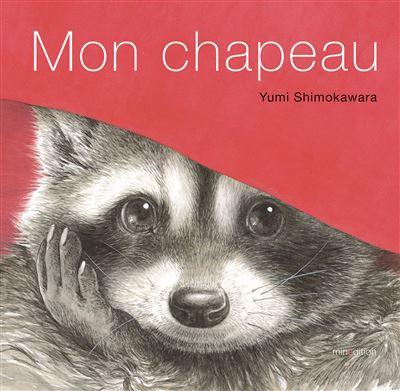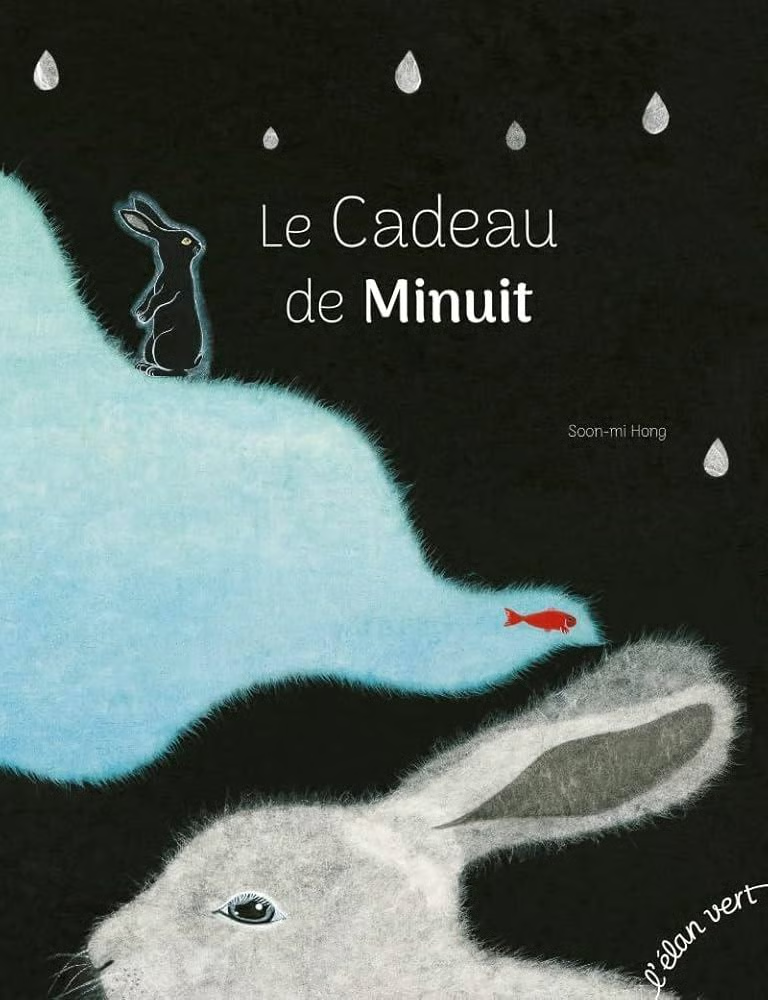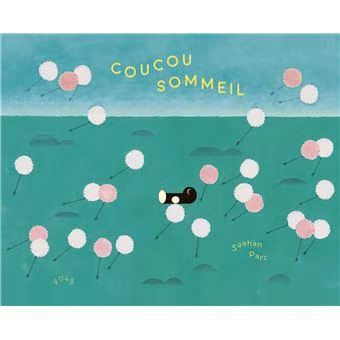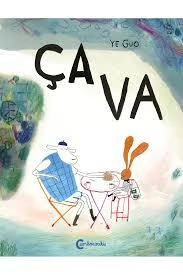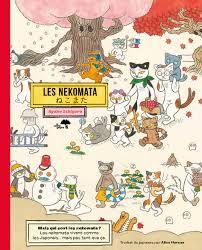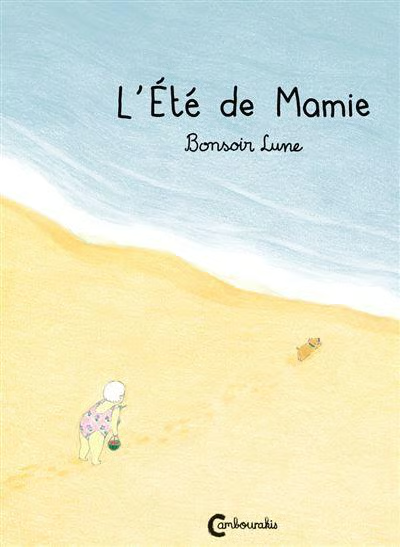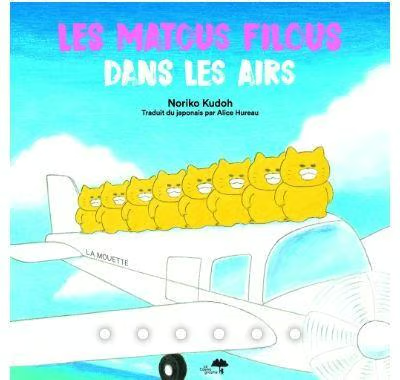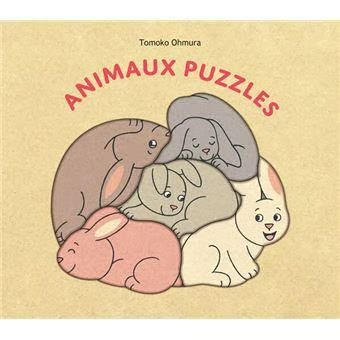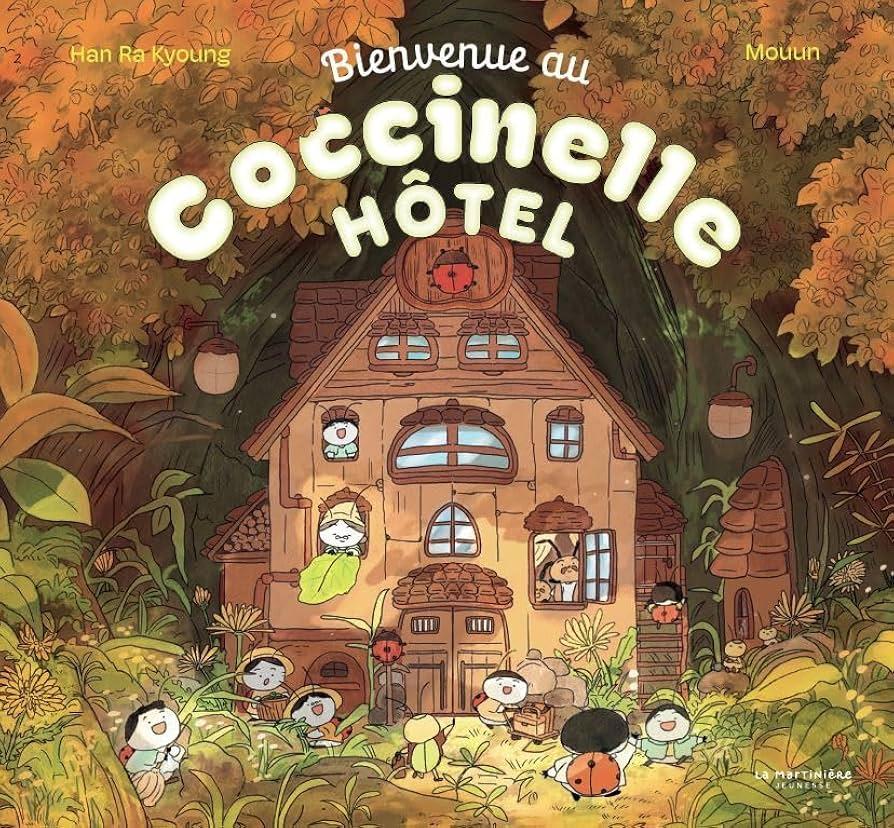L'ENFANT ET L'EMPIRE...
L’enfant et l’Empire. Poétiques de l’Inde coloniale dans Kim de Kipling (1901) et Swami and friends de R.K. Narayan (1935), ou la littérature par l’enfance
article publié dans la revue STRENAE
Résumé
Si l’enfant dans la littérature coloniale vient en général servir l’orientation idéologique de celle-ci, il peut aussi subtilement la perturber, comme en témoigne le célèbre roman de Kipling, Kim (1901) mais aussi bien une œuvre de la littérature indo-anglaise qui évoque la lutte pour l’Indépendance : Swami and Friends (1935) de R. K. Narayan. Dans l’un et l’autre roman, l’enfant vient saper le dispositif idéologique et assure le triomphe d’une littérature non pas tant pour l’enfance que par l’enfance : l’Inde dans Kim apparaît comme une spatialisation enchantée du temps de l’enfance d’où l’univers du colonat, très présent dans les Plain Tales of the Hills, s’évanouit, tandis que le protagoniste enfantin de Swami and Friends permet à R.K. Narayan de développer l’écriture distanciée, tout en ironie et suggestion, qui deviendra son style.
Entrées d’index
Mots-clés :
enfant, ironie, Kipling, littérature coloniale, littérature indienne, littérature pour la jeunesse, Narayan
Géographique :
Texte intégral
- 1 Jean- Marc Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, 1998, p. 109-110.
1Dans le dispositif de la littérature coloniale qui, comme le rappelle Jean-Marc Moura1, se définit par un critère stylistique, le réalisme, et un critère idéologique, l’approbation plus ou moins forte de la colonisation, le premier étant généralement mis au service du second, la figure de l’enfant joue souvent un rôle décisif, manifeste par le développement quasi parallèle d’une littérature coloniale et d’une littérature coloniale pour la jeunesse : l’œuvre prolifique de George Alfred Henty (1832-1902) en Grande-Bretagne, par exemple, révèle la congruence entre le discours de la littérature pour la jeunesse et celui du colonialisme. L’enfant, à la fois destinataire et héros, permet en effet de dégager le récit de la toute-puissance de l’exotisme, et d’envisager une action. Bien après la fin de la tentative d’Empire français en Inde au xviiie siècle, on trouve trace du procédé dans Dupleix, conquérant des Indes fabuleuses, de L. Luceney, paru en 1946 aux éditions Zimmermann dans la « Collection de l’impossible », qui s’ouvre par un chapitre d’ordre téléologique intitulé « Dupleix et la Begum Jeanne », mettant en scène les héros enfants, le petit Joseph dans le manoir breton de son enfance subissant les punitions injustes de son père, la petite Jeanne à Madras écoutant les « histoires de Rajahs » narrées par sa grand-mère.
- 2 http://www.larevuedesressources.org/spip.php?article544, 30 janvier 2006.
- 3 The British Image of India: a Study in the Literature of Imperialism 1880-1966, London, Oxford Univ (...)
- 4 Voir par exemple Émilienne Baneth-Nouailhetas, Le roman anglo-indien de Kipling à Paul Scott, Press (...)
2En marge de cette représentation conventionnelle de l’enfant dans la littérature coloniale, et du colonialisme dans la littérature pour la jeunesse – deux représentations qu’il conviendrait d’étudier systématiquement –, on s’intéressera ici à deux cas singuliers, mais significatifs de ce que la littérature a pu mettre en œuvre pour évoquer la réalité complexe de la colonisation. La littérature coloniale elle-même est loin d’être monologique : comme l’écrit Yves Clavaron dans un article intitulé « Marges et frontières dans la littérature coloniale2 », « elle porte en elle une série de ruptures et d’antagonismes, qui affectent tout autant la position de l’écrivain que la thématique et l’écriture ». Allan J. Greenberger, dans The British Image of India3, repère ainsi une évolution dans la littérature dite du Raj, c’est-à-dire la littérature anglo-indienne, écrite par des colons anglais installés en Inde : après une phase de confiance, de 1890 à 1910, une ère du doute s’ouvre, creusée par le traumatisme qu’a constitué la première guerre mondiale pour les puissances coloniales européennes. Dès 1901 cependant, Kim de Kipling déployait une remarquable complexité, or cette complexité, désormais reconnue par la critique récente inspirée par les travaux d’Homi K. Bhabha sur le sujet colonial4, doit, nous semble-t-il, être mise en relation dans ce roman précis avec le personnage d’enfant qu’est Kim. Le protagoniste enfantin est un extraordinaire facteur de subtilité narrative : c’est ce qu’on entreprendra de montrer dans le roman de Kipling, et on en trouvera confirmation avec un autre personnage d’enfant, issu d’un récit également contraint par la politique, mais dans un sens opposé, puisqu’il s’agit d’un roman écrit à la toute fin du Raj par un Indien, R. K. Narayan : Swami and Friends (1935).
Kim, l’enfant comme faille
- 5 Rudyard Kipling, Song of Myself and Other Autobiographical Writings, éd. T. Pinney, Cambridge, Camb (...)
3Pour comprendre comment Kim, œuvre d’un écrivain qui a pu passer pour le chantre de l’impérialisme britannique, accomplit une sorte de miracle poétique dépassant les intentions de son auteur lequel, dans son autobiographie, juge le récit « nakedly picaresque and plotless5 », sans doute faut-il rappeler à quel point l’Inde chez Kipling est une expérience d’enfance et à partir de là, l’expérience et le lieu de l’enfance par excellence. Fils d’un dessinateur céramiste nommé professeur à l’école des Beaux-Arts de Bombay, Kipling est né en Inde, en 1865, et y a vécu ses six premières années avant de subir ce qu’il vécut comme un déchirement : la pension en métropole. C’est cette dimension autobiographique, approfondie par l’expérience de la paternité et l’écriture des Jungle Books puis, deux ans avant Kim, le drame de la perte de sa fille aînée, âgée de sept ans, qui permet de comprendre comment le jeune auteur au succès précoce – les Plain Tales from the Hills sont composés en 1888 pendant le bref retour en Inde – en vient à proposer avec Kim une véritable immersion dans l’univers indien, saluée par les Indiens eux-mêmes : « the finest novel in the English language with an Indian theme », aux dires de l’essayiste bengali Nirad Chaudhuri.
4Il est vrai que Kim n’est pas n’importe quel enfant et que sa personnalité engage le récit dans des voies multiples : orphelin livré à lui-même puis bénéficiant de protections variées, anglaises et indiennes, être double, à l’identité brouillée, ayant perdu la deuxième syllabe de son prénom Kimball et son patronyme complet, O’Hara, désanglicisé en quelque sorte et corollairement indianisé – il vit comme un indigène, ressemble d’ailleurs à ceux-ci, et emploie sa langue maternelle comme une langue étrangère –, le personnage entraîne le récit vers le roman picaresque aussi bien que le roman d’aventures, deux genres qui conviennent assez bien à l’idéologie coloniale, sauf peut-être en ce que la narration s’en trouve fragmentée, désarticulée, comme Kipling se le reprochait. Pour Kipling, en effet – et ce sera la base du fossé qui se creusera avec les colonialistes britanniques – l’Empire est d’abord une aventure, une épreuve (celle à laquelle invite le poème « The White Man’s Burden » en 1899), une expérience qui permet de rester un boy. Mais c’est précisément cette perspective, qui pourrait soutenir l’écriture d’une littérature coloniale pour la jeunesse, qui contribue au contraire à défaire le point de vue du colon, car c’est bien en tant qu’enfant absolu, man’s cub, « petit d’homme » comme il est dit dans Le Livre de la Jungle, et non petit homme – de ce point de vue Kim est un roman de formation tout à fait paradoxal, sans aspiration à l’âge adulte – que le protagoniste introduit comme un coin dans l’idéologie coloniale.
5Dès l’incipit du roman s’impose un brouillage des points de vue et des voix, permis par le discours indirect libre et la citation de dictons réels ou supposés, mais aussi par le recours à un langage imagé, dont on ne sait s’il faut l’attribuer à la consommation d’opium par le père de Kim, ou à une adaptation de son propos à son destinataire enfantin :
- 6 Rudyard Kipling, Kim, Penguin Books, London, p. 50.
Those things [trois documents officiels], he was used to say, in his glorious opium-hours, would yet make little Kimball a man. On no account was Kim to part with them, for they belong to a great piece of magic – such magic as men practised over yonder behind the Museum, in the big blue-and-white Jadoo-Gher – the Magic House, as we name the Masonic Lodge6.
- 7 Traduction de Louis Fabulet, Folio, p. 39.
- 8 « the old Ajaib-Gher – the Wonder House, as the natives call the Lahore Museum », op. cit., p. 49.
6La fin du passage cité (« le grand Jadoo-Gher bleu et blanc, la Maison des sortilèges, comme nous appelons la Loge maçonnique7 ») fournit un exemple d’une des caractéristiques de ce discours qui porte le récit dans Kim : il pratique la renomination. Dès la première phrase, on pouvait lire : « Ajaib-Gher – la Maison des merveilles, comme les indigènes appellent le musée de Lahore8 » – musée dont le père de Kipling fut curateur. Or, si à la suite d’Edward Said et d’Elleke Boehmer, on considère l’acte colonisateur comme un acte de langage et de nomination – et, symboliquement, Kim, apprenti-sahib, sera affecté au « service topographique de l’Inde » (Survey of India) – il y a là un remarquable renversement : ce sont les réalités de l’Inde coloniale (le musée, la loge maçonnique) qui reçoivent des appellations indigènes, que le narrateur traduit, en les reprenant ainsi à son compte, comme le suggère le « we » à la fin du passage cité. Tout se passe comme si, dans le sillage de Kim et de l’appréhension enfantine des choses qu’il appelle, le point de vue indigène venait à s’imposer, dans lequel se révèle la dimension « magique » de l’Europe, constructrice de Maison(s) des merveilles (Wonder House) et de Maison(s) des sortilèges (Magic House).
7De la même façon, ce qui fut appelé le Grand Jeu (the Great Game) par les puissances européennes, la rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne en Asie, se découvre avec Kim à prendre littéralement, c’est-à-dire comme un jeu, dont la seule signification profonde, le jeu d’illusions et d’apparences qu’on appelle dans la pensée indienne la mâyâ, échappe totalement à ses joueurs occidentaux :
But Kim slept little and his thoughts ran in Hindustani : « Well is the Game called great ! I was four days a scullion at Quetta, waiting on the wife of the man whose book I stole. And that was part of the Great Game! From the South – God knows how far – came up the Mahratta, playing the Great Game in fear of his life. Now I shall go far and far into the North playing the Great Game […] »
8L’enfant se fait ainsi porteur du seul regard juste sur l’Inde, regard qui déjoue les leurres des images (exotiques) en révélant la vérité des métaphores, regard qui se confond donc avec une appréhension de l’Inde de l’intérieur – on notera que Kim pense en hindi –, à la fois enfantine et indigène, et qui trouve une seconde incarnation au sein du roman dans la figure du lama, également étranger et familier de l’Inde à la fois, et éternel enfant (le caractère enfantin du personnage est un leitmotiv du récit).
- 9 Op. cit., p. 105.
- 10 Kim découvrira par la suite que ces années d’études ont été payées par le lama : il n’y a pas antag (...)
9Contre la saisie géométrique du territoire, le roman propose donc une appréhension synthétique, voire synesthésique du monde indien dont les routes, parcourues par l’enfant et le lama, sont, au sens propre, les voies d’accès, la Grand Trunk Road qui traverse le pays de Bombay jusqu’à la frontière septentrionale tout particulièrement, que le récit dote, par la métaphore « river of life9 », d’un mouvement propre, d’une âme même, la rendant comparable à un fleuve sacré, une sorte de second Gange. Mais les routes plus modestes au pied de l’Himalaya offrent semblablement à l’enfant, qui a retrouvé le lama après trois ans à Saint-Xavier à Lucknow10, un moment de bonheur dans le giron de l’Inde, qui est en même temps accès à un second niveau de réalité :
- 11 Op. cit., p. 260.
When the shadows shortened and the lama leaned more heavily upon Kim, there was always the Wheel of Life to draw forth, to hold flat under wiped stones, and with a long straw to expound cycle by cycle. Here sat the Gods on high – and they were dream of dreams. Here was our Heaven and the world of the demi-Gods – horsemen fighting among the hills11.
- 12 Traduction L. Fabulet, op. cit., p 326 ; « for by the roadside trundled the very Wheel itself, eati (...)
10Dans l’alternance des marches et des repos, c’est, non la sagesse (les personnages mendient les yeux errant d’un bord du ciel à l’autre, « in defiance of the Law »), mais le récit de celle-ci, la mise en fiction de la Roue de la vie bouddhiste par le lama, et surtout le récit en général, démultiplié (« There they told their tale – a new one each evening as far as Kim was concerned – »), qui provoquent cet approfondissement du réel. Les objets du récit des personnages deviennent en effet dans la narration objets de la réalité indienne au même titre que la route elle-même, les villages, etc. Le récit du moine se fond avec la voix du narrateur par un effet du discours indirect libre (« Here was our Heaven ») ; les niveaux de fiction se rejoignent « car au bord de la route, tournait la Roue même, mangeant, buvant, faisant des affaires, épousant et querellant – toute chaude de vie12. » Le récit suscite le réel, le réel suscite le récit : dans une confusion qui évoque évidemment la conception enfantine de la fiction, l’Inde se fait fondamentalement récit, non pas objet d’un discours (colonialiste) à la fois étranger, inquiet et contempteur, mais terre où l’on raconte, qui se raconte et que, sur cette base, on peut raconter.
11Le regard enfantin est donc une écriture, l’Inde apparaît comme la spatialisation enchantée du temps de l’enfance d’où l’univers du colonat, très présent dans les Plain Tales of the Hills, s’évanouit, tandis que l’Inde des Indiens, ou du moins son récit, semble délivrer la promesse d’une enfance à laquelle il n’est pas nécessaire de renoncer – on songe à James Barrie, dont Peter Pan, apparu en 1902 dans The Little White Bird est, à un an près, contemporain de Kim. Faut-il penser à partir de là que l’Inde ait tenu lieu pour Kipling de prétexte ? On supposera plutôt que la littérature pour la jeunesse a pu lui apparaître comme une des rares façons d’évoquer l’Empire tel qu’il le concevait. Quoi qu’il en soit, après Kim, le malentendu avec ses contemporains se creusant, Kipling n’écrira pratiquement plus qu’à destination des enfants, les Just So Stories (1902) et Puck of Pook’s Hill (1906).
12Roman de l’enfance et du temps, Kim n’était cependant pas conçu comme roman pour enfant : tel est le paradoxe d’une littérature par l’enfance, où l’enfant n’est pas tant destinataire que clé poétique, dispositif subtil, fragile, pas toujours compris, qu’illustre aussi remarquablement, et comme en miroir, un roman de la littérature indo-anglaise naissante, Swami and friends.
Swami and friends, l’enfant comme écart
- 13 Mais il aborde celles-ci de façon beaucoup plus explicite et critique dans son autobiographie My Da (...)
13Si la littérature coloniale est un produit de la colonisation, la littérature indienne anglophone – comme le genre romanesque dans le système littéraire indien – ne l’est en un sens pas moins, même si elle vient souvent répondre aux écrits de la première en les contestant. Les premiers romans en anglais signés par des Indiens paraissent au lendemain de la révolte des Cipayes (1857) ; il faut toutefois attendre le début du xxe siècle pour voir surgir la première génération de romanciers indo-anglais de premier plan, à laquelle appartient Rasipuram Khrishnasvami Narayan, né à Madras en 1907, mort en 2001. À la différence de ses contemporains, Mulk Raj Anand, Raja Rao, issus comme lui des castes dominantes et anglicisées, R. K. Narayan, lycéen médiocre, étudiant distrait, ne poursuivit toutefois pas d’études en Grande-Bretagne, et ne quitta le sud de l’Inde de son enfance qu’au seuil de la cinquantaine, se désintéressant, a priori du moins, de la puissance coloniale et de sa domination sur l’Inde13.
14Les romans de R. K. Narayan s’installent ainsi dans le rejet du réalisme, puisqu’ils se situent dans une petite ville imaginaire, Malgudi, ville cependant très évidemment indienne, ressemblant à Mysore, ville du sud de l’Inde où a vécu Narayan, avec sa classe moyenne, des brahmanes – comme lui –, éduqués à l’anglaise, professeurs, journalistes, fonctionnaires, imprimeurs. Or, l’écriture remarquable, et paradoxalement très remarquée dans le monde anglophone (par Graham Greene, Henry Miller, John Updike), de ces romans à la fois anglais et indiens, dépaysants et familiers, a été inventée par Narayan avec un premier récit datant de 1935 dont le point de vue enfantin, peut-on penser, a permis à l’auteur de traiter avec distance le cours de l’Histoire contemporaine, en petites touches anecdotiques, et de construire, d’un point de vue formel, un anti-roman d’apprentissage, comparable en ce sens à Kim.
- 14 R.K. Narayan, A Malgudi Omnibus, Minerva, 1994, p. 8.
15Swami and friends narre les aventures d’un fils de magistrat de Malgudi dans les années trente. L’enfant se trouve à plusieurs reprises mêlé à des événements de portée plus collective, et c’est alors que l’auteur semble se plaire à n’en montrer qu’une réalité parcellaire et dérisoire, en s’appuyant sur le point de vue de son petit protagoniste. C’est le cas d’emblée, au chapitre premier : le petit Swami reçoit à l’école l’enseignement colonial dont il apprécie tout particulièrement le cours d’histoire donné par M. Pillai (un brown sahib, c’est-à-dire un Indien enrôlé dans l’administration coloniale), qui raconte « with wealth of details the private histories of Vasco da Gama, Clive, Hastings, and others14 » … Le discours violemment anti-hindou du professeur d’histoire sainte suscite cependant chez le petit brahmane la question naïve suivante à propos du Christ : « If he was a god, why did he eat flesh and fish and drink wine ? », question qui reçoit pour réponse une oreille tirée en bonne et due forme. Swami se plaint à son père, lequel rédige aussitôt une lettre de protestation à l’intention du principal, où il dénonce ces pratiques unchristian. Mais la contestation tourne court aussitôt, et se trouve ramenée à un incident scolaire, en l’absence de tout enjeu politique. La naïveté enfantine ébranle un instant les évidences du monde colonial, mais sans que la narration s’y arrête.
16Le phénomène se reproduit en s’amplifiant à mi-roman, chapitre 12. Le récit s’ouvre avec une date, « On the 15th of August 1930 », date prémonitoire puisque l’indépendance de l’Inde a été proclamée exactement dix-sept ans plus tard. Par cet ancrage temporel, l’auteur confère à la diégèse une dimension historique, d’autant que l’événement du jour est la manifestation de deux mille habitants de Malgudi pour protester contre l’arrestation d’un militant de Bombay, Gauri Sankar, dont le nom est celui d’un sommet de l’Himalaya. Un discours est prononcé, qui passe largement au-dessus de la tête du petit Swami. Mais ce n’est pas seulement parce que le fond du discours n’est pas compréhensible par le héros, c’est que le discours lui-même a quelque chose d’incompréhensible, dans ses aberrations en tout genre (les Anglais à l’âge préhistorique à l’époque de l’Inde classique, la jungle en Angleterre, la noyade de l’Angleterre dans la salive de l’Inde comme programme politique). La scène prend alors un tour ridicule, colorant d’une touche d’absurdité le mouvement de désobéissance civile. Au moment où l’orateur au nom himalayen, juché sur une plate-forme, vilipende d’un ton haut perché la soumission des Indiens et appelle à cracher sur l’Angleterre, Swami se surprend à crier mécaniquement : « Gandhi ki jai », « Vive Gandhi ! ». Or, en ne faisant par cette exclamation inopportune qu’anticiper la réaction attendue de l’auditoire, l’enfant perroquet mine en le mimant l’enthousiasme nationaliste, et semble manifester l’impossibilité de sortir d’une logique d’aliénation. Son point de vue extérieur, qui porte l’ensemble de la narration, ne se contente pas de réduire puérilement le jour historique à une occasion de désobéissance scolaire ; il suggère l’inanité, la puérilité de toute action :
- 15 Op. cit., p. 80.
Swaminathan’s part in all this was by no means negligible. It was he who shouted : “we will spit on the police” (though it was drowned in the din), when the headmaster mentioned the police15.
17Dans sa naïveté, l’enfant signale l’absurdité du monde et du cours des choses, sans y échapper lui-même pour autant. Il permet d’introduire l’ironie du narrateur qu’il subit en même temps à ses dépens, les deux précisions finales ici, la parenthèse, et la circonstancielle tempérant largement l’affirmation première, et révélant l’ironie de sa double négation.
18Bien qu’également soutenu par une expérience autobiographique, le personnage enfantin entraîne donc chez Narayan une poétique quasiment inverse de celle de Kim : le petit être toujours un peu décalé dans le monde des adultes qu’est l’enfant en érode le sérieux, en sape l’historicité. La représentation de l’Empire qui en découle est cependant assez proche. Si l’idéologie coloniale de Kipling s’évanouissait dans Kim, sa contrepartie anticolonialiste dans Swami and friends ne parvient tout simplement pas à exister : jouant avec les attentes du lecteur, R.K. Narayan, sans ignorer la grande Histoire qui secoue l’Inde, ne cesse de ramener son récit aux dimensions ordinaires, naturellement héroïco-comiques, d’une existence enfantine dont les principales occupations et perturbations sont les « copains » du titre, la naissance d’un petit frère, le passage dans la classe supérieure, l’équipe de cricket.
- 16 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article, « R. K. Narayan, méprise occidentale sur une (...)
19L’enfant, être d’ironie au sens où celui-ci permet un discours d’ignorance feinte, inaugure pour Narayan une écriture distanciée, tout en suggestion qui, dès le volume suivant (The Bachelor of Arts, 1937), se passe de figure enfantine, mais conserve un sens de la dérision qui n’est pas sans évoquer l’humour anglais mais, plus profondément, s’ancre dans l’aspiration indienne au détachement, au renoncement. The English Teacher (1945), le troisième volume de ce qui deviendra, non sans quelques décrochages, une trilogie, peut dès lors accomplir une « décolonisation littéraire16 », c’est-à-dire mettre en place un romanesque au réalisme réinventé, d’autant plus remarquable que le récit est cette fois mené à la première personne. On peut noter la proximité des incipit des deux récits :
- 17 Swami and friends, op. cit., p. 7.
- 18 The English Teacher, in A Malgudi Omnibus, op. cit., p. 295.
It was Monday morning. Swaminathan was reluctant to open his eyes. He considered Monday specially unpleasant in the calendar. After the delicious freedom of Saturday and Sunday, it was difficult to get into the Monday mood of work and discipline17.
I was on the whole very pleased with my day – not many conflicts and worries, above all not too much self-criticism. I have done almost all the things I wanted to do, and as a result I felt heroic and satisfied. The urge had been upon me for some days past to take myself in hand. What was wrong with me ? I couldn’t say, some sort of vague disaffection, a self-rebellion I might call it18.
20Touché par l’ironie enfantine, le narrateur de The English Teacher, jeune professeur d’anglais à l’Albert Mission College (le même établissement que dans Swami and friends), reconnaît et approfondit peu à peu le décalage entre la routine anglicisée de l’école et une sourde aspiration au vide chez lui, que savait goûter l’enfant mais qui impliquera pour l’adulte le passage par l’épreuve de la perte de son épouse, avec laquelle il entrera en contact après sa mort grâce à un médium, avant de démissionner de son poste. L’ironie enfantine est ainsi prise au sérieux par la narration, mais sans devenir l’objet d’une quelconque formulation idéologique sérieuse. Et c’est dans cette ironie que l’Inde est retrouvée par le narrateur, comme celle qui précisément abolit l’opposition entre vide et plein, absence et présence. Par son art de l’écart et de la diversion plus que de la confrontation, l’enfant serait-il donc le véritable adversaire à la mesure de l’Empire ? Gandhi sans doute n’aurait pas dit le contraire, même si seule la fiction peut à ce point délester l’Inde et le combat pour l’indépendance de tout contenu. Aux policiers qui chargent la foule et l’appréhendent brutalement, Swami déclare :
- 19 Op. cit. p. 82.
« I don’t know anything, leave me, Sirs » […]
« Doing nothing ! Mischievous monkey !, said the grim, hideous policeman – how hideous policemen were at close quarters19 !
21La lutte est rien, même si elle n’est pas nulle et non avenue, comme le signale le mépris odieux de l’agent du pouvoir colonial, dont la diabolisation est cependant aussitôt désamorcée par l’incise comique.
- 20 Le Livre de Poche, traduction d’Anne-Cécile Padoux, couverture et illustrations de Françoise Boudig (...)
22La traduction française de Swami and friends a fait l’objet en 1986 d’une édition pour enfants (« À partir de 8-9 ans »), illustrée et annotée remarquablement20. Comme Kim, le roman de Narayan n’était pas destiné aux enfants et ce choix éditorial témoigne en un sens d’une méconnaissance de l’art ironique de Narayan. Toutefois, comme Kim, Swami and friends développe une poétique qui le rend sans aucun doute lisible par un enfant comme par un adulte : si Kim donne à voir l’Inde comme l’enfance même, remplaçant l’exotisme colonial par un autre enchantement, Swami and friends fait de l’enfant indien un double de tout enfant, dans une familiarité qui est pour une part illusion. Aussi les deux œuvres peuvent-elles toujours être soupçonnées de déshistoricisation opportune. Mais on pourra considérer, au contraire, qu’elles évoquent de la façon la plus subtile la réalité piégée de l’Empire ; c’est du moins ce qu’a voulu suggérer la lecture ici esquissée.
Notes
1 Jean- Marc Moura, L’Europe littéraire et l’ailleurs, Paris, PUF, 1998, p. 109-110.
2 http://www.larevuedesressources.org/spip.php?article544, 30 janvier 2006.
3 The British Image of India: a Study in the Literature of Imperialism 1880-1966, London, Oxford University Press, 1969.
4 Voir par exemple Émilienne Baneth-Nouailhetas, Le roman anglo-indien de Kipling à Paul Scott, Presses de la Sorbonne nouvelle, 1999.
5 Rudyard Kipling, Song of Myself and Other Autobiographical Writings, éd. T. Pinney, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 132.
6 Rudyard Kipling, Kim, Penguin Books, London, p. 50.
7 Traduction de Louis Fabulet, Folio, p. 39.
8 « the old Ajaib-Gher – the Wonder House, as the natives call the Lahore Museum », op. cit., p. 49.
9 Op. cit., p. 105.
10 Kim découvrira par la suite que ces années d’études ont été payées par le lama : il n’y a pas antagonisme entre le monde indigène et le monde colonial, mais intégration du colonial dans quelque chose qui le dépasse.
11 Op. cit., p. 260.
12 Traduction L. Fabulet, op. cit., p 326 ; « for by the roadside trundled the very Wheel itself, eating, drinking, trading, marrying, and quarrelling – all warmly alive. »
13 Mais il aborde celles-ci de façon beaucoup plus explicite et critique dans son autobiographie My Days (1973) et ses essais, tel « When India was a colony », repris dans A Writer’s Nightmare (1988).
14 R.K. Narayan, A Malgudi Omnibus, Minerva, 1994, p. 8.
15 Op. cit., p. 80.
16 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon article, « R. K. Narayan, méprise occidentale sur une décolonisation littéraire, Revue de littérature comparée 3/2002 (n° 303), p. 323-342. Je reprends en les adaptant certaines analyses qui y sont développées.
17 Swami and friends, op. cit., p. 7.
18 The English Teacher, in A Malgudi Omnibus, op. cit., p. 295.
19 Op. cit. p. 82.
20 Le Livre de Poche, traduction d’Anne-Cécile Padoux, couverture et illustrations de Françoise Boudignon.
Pour citer cet article
Référence électronique
Claudine Le Blanc, « L’enfant et l’Empire. Poétiques de l’Inde coloniale dans Kim de Kipling (1901) et Swami and friends de R.K. Narayan (1935), ou la littérature par l’enfance », Strenæ [En ligne], 3 | 2012, mis en ligne le 15 février 2012, consulté le 10 janvier 2019. URL : http://journals.openedition.org/strenae/559 ; DOI : 10.4000/strenae.559
Droits d’auteur

Strenae est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.